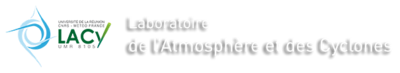Agenda 2025
Mardi 14 janvier 2025 à 14h00 en salle OSU-R, Hélène Vérèmes (LACy)
Prévision mensuelle de l'activité cyclonique dans le sud-ouest de l'océan Indien : exemple d'utilisation en contexte opérationnel
Agenda 2024
Après sa présentation durant l'école d'été Maïdo Observatory Summer School s'étant tenue du 18 au 22 novembre, Bernard Legras propose un séminaire sur "La découverte, l'explication et l'impact des anticyclones persistants de fumées et poussières dans la stratosphère" ouvert à tous.
Il se déroulera en salle OSU-Réunion, sur le campus du Moufia à l'Université de la Réunion, le vendredi 29 novembre 2024 à 09h30.
Jeudi 27 novembre - Salle de réunion OSU-R - Daniel Fortunato (UPC)
Synergetic data processing of combined aerosol remote sensing observations
Mercredi 26 novembre - Salle OSU-R - Daniel Fortunato (UPC) - Multi-Sensor Aerosol Inversions
Multi-Sensor Aerosol Inversions
I. Inputs and data preparation
II. Hands-on data preparation
Mercredi 14 février 2024 à 11h en salle OSU-R, Guillaume Guimbretière (LACy)
Le problème de la non-durabilité de la Recherche moderne
Partant du contexte socio-écologique de contraction de la disponibilité en ressources énergétiques et minérales, cette intervention est une invitation à réfléchir au sens et à la nature de la « durabilité » d’une instrumentation scientifique.
Pour cela, la démarche low-tech offre un cadre de pensée prometteur [1]. Descendante d’un courant techno-critique historique [2], elle questionne la consommation de ressources, la pollution, la durabilité, l’utilité et l’accessibilité des réponses technologiques aux besoins des citoyens. Dans la présentation, passant des besoins du citoyen à celui du scientifique, je reprends des concepts issus de la philosophie des techniques et des sciences de la durabilité, afin de prendre du recul et de réfléchir collectivement au devenir de l’instrumentation scientifique.
[1] G. Guimbretiere, S. Hodencq, M. Balland. « Une approche de la Low-tech dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche ». La pensée écologique (Mars 2022).
[2] F. Jarrige. Technocritiques - Du refus des machines à la contestation des technosciences. Ed. La Découverte (2016)
Agenda 2023
Agenda 2022
Agenda 2021
JANVIER
Jeudi 21 Janvier à 10h en salle OSUR , Thibaut Dauhut (CNRM)
Hydratation de la stratosphère par la convection : du système convectif très profond au bilan sur les tropiques
Les systèmes convectifs très profonds se développent jusqu’à la stratosphère et y transportent de l’eau sous la forme de glace. Ce transport n’est pas représenté par les modèles à résolution trop grossière, ce qui limite notre capacité à prévoir le climat futur. Les processus pilotant ce transport sont analysés sur un cas d’étude simulé avec le modèle Méso-NH, puis la contribution de la convection à l’entrée d’eau en stratosphère est calculée à partir d’une simulation globale réalisée avec le modèle ICON.
L’orage très profond Hector the Convector est simulé avec une résolution de 100 m qui permet de représenter explicitement les percées nuageuses à son sommet et les grands tourbillons à l’origine du mélange entre l’air troposphérique et stratosphérique. Le processus clé de l’hydratation est l’entraînement sommital d’air stratosphérique, ce qui explique que les percées les plus élevées – qui entraînent de l’air à température potentielle plus élevée – produisent une plus forte hydratation.
L’atmosphère globale est simulée pendant un mois d’été boréal avec une résolution de 2,5 km permettant de représenter les systèmes convectifs très profonds. Le bilan d’eau de la stratosphère tropicale indique que l’humidification sur la période simulée est le résultat de l’advection verticale d’humidité et de l’hydratation par les processus microphysiques et turbulents, partiellement compensées par les flux d’eau horizontaux vers les pôles. Bien que l’augmentation de l’humidité apparaît localement limitée au-dessus des systèmes convectifs très profonds, le bilan d’eau révèle que ces systèmes contribuent à environ 1/6 de l’entrée d’eau dans la stratosphère tropicale.
Agenda 2020
Février
Jeudi 20 février à 9h30 en salle OSUR, Jonathan Durand (LACy)
I - LE RADAR NUAGE BASTA
Deux années d'observations radar sur les nuages, recueillies par un radar à 95 GHz déployé sur le toit de l'université de la Réunion, sont analysées pour étudier les propriétés de la couverture nuageuse. Les mesures recueillies par ce radar, une fois validées par rapport à d'autres sources de données, sont utilisées pour étudier la distribution verticale et temporelle des nuages dans cette zone tropicale particulièrement sujette aux fortes précipitations. Pendant l'été austral, deux couches nuageuses principales peuvent être observées : entre 1-3 km d'altitude (fréquence d'occurrence de 45%) entre 08:00 UTC et 15:00 UTC et 8-12 km d'altitude (fréquence d'occurrence de 15% entre 10:00 UTC et 15:00 UTC), en relation avec un cycle diurne très fort et une forte instabilité convective. En hiver austral, la fréquence d'apparition des nuages est la plus élevée entre 09:00 UTC et 14:00 UTC, avec une probabilité maximale d'environ 35%, mais seuls quelques nuages peuvent se développer à moyenne et haute altitude. Une distribution verticale inhabituelle de la fraction nuageuse est également observée au cours de l'hiver austral 2017, très similaire à celui d'un été austral. Cet événement inhabituel semble lié à la présence d'un fort SIOD,apportant une grande quantité d'humidité sur l'île de la Réunion.
Une comparaison de la fraction nuageuse observée par le radar avec AROME-IO pendant cet hiver particulier indique que le modèle n'a pas pu reproduire la distribution verticale des nuages avec une sous-estimation de la couverture nuageuse dans les couches les plus basses.
II - INSTALLATION DE STATIONS GNSS ET MÉTÉOROLOGIQUE DANS LE BASSIN INDIEN
Présentation des installations les plus notables dans le bassin indien rentrant dans le cadre des projets RenovRisk et IOGA4MET.
Agenda 2019
Décembre
Mercredi 4 décembre à 14h en salle OSUR, Pétronille Kafando (Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina-Fasso)
Caractéristiques des ondes de gravité durant la mousson africaine (La campagne AMMA)
Le Sahel, localisé en Afrique de l’Ouest (entre 11°N et 20°N), est une région extrêmement vulnérable aux changements de régime des pluies, qui ont un impact important sur les activités socio-économiques, avec des conséquences souvent désastreuses sur les ressources en eau, l’agriculture, l’élevage, la santé, .....
Le programme AMMA (Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine ; www.amma-eu.org), initié depuis 2001 en Afrique de l'Ouest, vise à appréhender le schéma complexe d'installation de la mousson de l’Afrique de l’Ouest (MAO), ses variabilités et les indicateurs associés ainsi que la représentation du climat africain à plus long terme.
Les ondes atmosphériques, dont les ondes de gravité, participent à la dynamique atmosphérique allant de la météorologie locale à la circulation globale. L’analyse des mesures radiosondages effectués durant la période d’observation intense AMMA 2006 ont permis de déterminer les caractéristiques des ondes de gravité stratosphériques observées durant la mousson africaine en régions tropicale et équatoriale. A l’issue de ces résultats, nous avons étudié le lien entre l’activité énergétique des ondes de gravité à long terme et la QBO de 2001 à 2009.
Octobre
Vendredi 11 octobre à 11h en salle OSUR, Alain Hauchecorne (LATMOS, Guyancourt, France)
La mesure de vent par lidar depuis le sol et l’espace
Le vent est une variable physique fondamentale de la météorologie au même titre que la température l’humidité et les nuages. Sa connaissance est indispensable pour obtenir de bonnes prévisions météorologiques. Contrairement à ces autres variables, le vent n’est pas actuellement mesuré directement depuis l’espace. Il peut être obtenu indirectement à partir du déplacement des nuages sur les images satellites. La mesure directe du profil de vent s’effectue en lâchant 2 fois par jour des ballons-sondes dans 500 stations météorologiques à travers le monde. La répartition de ces stations est très inhomogène avec une forte concentration dans les régions développées dans les régions développées de l’hémisphère Nord et un très petit nombre au dessus des océans et dans l’hémisphère sud.
La technique lidar, consistant à analyser le signal de retour d’une impulsion laser diffusée par les différentes couches de l’atmosphère, permet d’obtenir des profils verticaux des variables atmosphériques. Le Service d’Aéronomie/LATMOS a été un des pionniers dans ce domaine en développant et en mettant en œuvre cette technique à l’Observatoire de Haute-Provence (OHP) dès les années 1970. Il a mis au point un lidar Doppler capable de mesure le profil de vent horizontal jusqu’à 60-70 km d’altitude s’appuyant sur la mesure du décalage spectral de la lumière laser diffusée par les molécules de l’air (diffusion Rayleigh). La technique mise au point au LATMOS a été reprise par l’Agence Spatiale Européenne dans la mission Aeolus embarquant un lidar Doppler pour la mesure du vent radial (projection du vecteur vent sur la ligne de visée du laser). L’objectif principal de cette mission est la démonstration de l’apport de l’assimilation des mesures de vent par lidar à la qualité des modèles de prévision météorologiques. Les mesures du satellite Aeolus lancé en août 2018 sont en cours de validation. Les lidars vent de l’OHP et de l’OPAR participent à cette validation. Une campagne intensive de mesures de vent a eu lieu au Maïdo au cours du mois dernier. Les premiers résultats obtenus montrent un bon accord entre les mesures lidar depuis le sol et depuis l’espace.
Septembre
Vendredi 20 septembre à 10h en salle OSUR, Bert Verreyken (LACy)
Development on FLEXPART-AROME and 18 months of PTR-MS measurements@Maïdo - PhD progress during my 2 year stay at LACy
Oxygenated Volatile Organic Compounds (OVOCs) significantly impact the atmospheric oxidative capacity and climate. The OCTAVE project (Oxygenated Compounds in the Tropical Atmosphere: Variability and Exchanges) aims to reduce uncertainties in global OVOC budget estimates by improving on OVOC and precursor sources and sinks in the tropical atmosphere. To achieve this, satellite retrievals, modelling efforts and additional in-situ measurements are combined. To achieve the latter, a Proton Transfer Reaction Mass-Spectrometry instrument (PTR-MS) has been deployed to the Maïdo observatory in October 2017. It will produce a two-year near-continuous three minute resolution data-set. To study the mesoscale impact of local sources and sinks on in-situ (O)VOC concentrations at the Maïdo observatory, a limited area version of the Lagrangian transport model FLEXPART, FLEXPART-AROME was developed. In FLEXPART-AROME, we developed the turbulent behaviour to be driven by turbulent kinetic energy fields obtained from the numerical weather prediction model. This in contrast to the independent turbulence parameterization used by FLEXPART which may result in inconsistent transport between the online weather predition model and the offline transport model.
I will be presenting the FLEXPART-AROME development, on which a paper has recently been accepted to GMD, together with some of the FLEXPART-AROME products currently available to study in-situ measurements at the Maïdo observatory. After this, I will present preliminary PTR-MS data. We will be going into some detail about data quality, comparing PTR-MS data with other measurements being performed at the observatory, look at seasonal impact and present a first preliminary positive matrix factorisation (PMF) analysis using a few days worth of data.
Juin
Jeudi 28 juin à 14h en salle OSUR, Keun-Ok Lee (Laboratoire d’Aérologie, Toulouse, France)
Moisture transport and processes in and around deep convective system
My talk is consist of two parts, i) first part is about moisture processes in the lower troposphere and its connection to the deep convection development, and ii) second part is about the moisture and aerosol transports into the stratosphere via convective overshoots.
The Part 1 focuses on the water vapour transported by the marine flow, which is a crucial ingredient of Mediterranean heavy precipitation events (HPEs). The realistic representation of its spatio-temporal variability in numerical weather prediction models is critical for HPE forecast. Predicting the initiation of convection in cloud resolving models can also be highly dependent on very accurate estimates of water vapor within and just above the boundary layer. The first Special Observation Period of the Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment (HyMeX, www.hymex.org) took place in autumn 2012, aiming to improve our knowledge of the origin and transport pattern of moist air masses in pre-convective conditions and determine the link between these air masses and HPEs. I introduce the IOP13 to investigate the impact of the environmental moisture structure in the lower troposphere (below 2 km above sea level, ASL) on the precipitation development with a series of numerical sensitivity experiments, and the moisture transport pathways with the help of stable water isotopologues.
In Part 2, I shift to the UTLS (upper troposphere and lower stratosphere). If air parcels within the convective core have enough upward momentum, they continue to rise beyond their equilibrium level of zero buoyancy, and form overshoots. The convective overshoot plays a key role in venting chemical constituents (water vapour, ozone, and aerosol) from the boundary layer and their export from source region to the UTLS, where they can impact chemically and radiatively important gases such as ozone and its precursors. The tropical aircraft campaign of the Stratospheric and upper tropospheric processes for better Climate predictions (StratoClim, www.stratoclim.org) took place in summer 2017. It aimed to improve our knowledge of the key processes, i.e. microphysical, chemical and dynamical processes, which determine the composition of the UTLS, such as the formation, loss, and redistribution of chemical constituents. I introduce the part of flight #7 showing the source and pathway of the moisture and aerosols in the TTL that was measured by aircraft in connection to a convective overshoot using a combination of airborne and spaceborne observations as well as a convection-permitting simulation (MNH and MNHC).
Jeudi 6 juin à 14h en salle OSUR, Florent Malavelle (University of Exeter, UK)
What Can We Learn about Aerosol–Cloud Interactions from Degassing Volcanic Eruptions?
English version:
Aerosol-cloud-interactions and climate sensitivity continue to be the two key uncertainties in our understanding of climate change. These are inter-related problems because models with a strong/weak aerosol cooling effect and a high/low climate sensitivity respectively are both able to represent the historic global mean temperature record. Aerosol-cloud-interactions operates via microphysical impacts reducing the size of cloud droplets (Twomey effect) and subsequent impacts on rain formulation which has been postulated to change the overall physical properties of clouds (Albrecht effect). The representation of the Twomey and Albrecht effects remain highly uncertain in climate models indicating they are poorly understood and poorly parameterised.
The major problem in reducing these uncertainties is the lack of suitable observations at globally relevant spatial scales with which to challenge the models. The fissure eruption at Holuhraun in 2014-2015 in Iceland emitted sulphur dioxide at a peak rate of up to 1/3 of global emissions, creating a massive aerosol plume across the entire North Atlantic 1 . In effect, Iceland became a significant global/regional pollution source in an otherwise unpolluted environment, creating an almost perfect analogy for anthropogenic emissions of sulphur dioxide. Analysis reveals that the strength of the Twomey effects varies between models, but strong Albrecht effect is likely in error 2.
While the eruption at Holuhraun was ideal because of the on/off nature of the emissions, there are other volcanic systems in remote environments that can also provide evidence that the Albrecht effect is very weak. This work analyses data from the world’s most consistent degassing volcanoes including Kilauea (Hawaii) and Ambrym (Vanuatu). The results show conclusively that, on average, the Albrecht effect is near-zero. While this conclusion might suggest that aerosol-cloud-interactions climate models could be significantly simplified and that those with a strong Albrecht effect should be re-evaluated, there may be impacts on individual clouds and precipitation extremes, which suggest that further work is necessary using the suite of models with different resolutions and the suite of in-situ and remote sensing observations that are now available to the aerosol and climate modelling communities.
1 Gettelman, A. et al., Nat. Geosci. 8, 243, doi:10.1038/ngeo2376, 2015
2 Malavelle, F. et al., Nature, 546, 485-491, doi:10.1038/nature22974, 2017
Version française :
Qu’est ce que les eruptions volcaniques de type effusive peuvent nous apprendre sur les interactions aerosol-nuage ?
Les interactions aérosol-nuage (aerosol-cloud-interactions, ACI) et la sensibilité climatique figurent encore parmi les principales incertitudes dans la compréhension du changement climatique. Ces deux problèmes sont liés car les modèles avec un faible/fort refroidissement du aux aérosols et une forte/faible sensibilité climatique sont capables de reproduire l’évolution de la température moyenne à l’échelle globale pendant la période historique. Les interactions aérosol-nuage opèrent à travers l’impact des aérosols sur la microphysique nuageuse qui réduit la taille des gouttelettes d’eau (effet Twomey) ce qui induit d’autres impacts sur la formation des précipitations. Il a été postulé que ces ajustements ont la capacité d’affecter les propriétés macro-physiques des nuages (effet Albrecht). La représentation dans les modèles de climat des effets Twomey et Albrecht reste très incertaine illustrant un manque de compréhension et de paramétérisations adaptées.
Le principal obstacle dans la réduction de ces incertitudes est lié au manque d’observations à grande échelle disponible pour confronter les modèles de climat. Cette situation a changé avec la fissure volcanique à Holuhraun (Islande) en 2014-2015. Holuhraun a émis de larges quantités de dioxyde de souffre (SO 2 ), atteignant près du 1/3 du taux des émissions globale au pic de l’éruption. Ces conditions ont fait émerger un vaste panache d’aérosols sulfatés au-dessus de l’Atlantique Nord 1. En pratique, l’Islande est devenue une source de pollution d’échelle régionale/globale dans un environnement relativement pristine, créant une analogie presque parfaite aux émissions anthropiques de SO 2 . L’analyse de l’impact du panache d’aérosols sur les propriétés des nuages fait ressortir que l’estimation de l’effet Twomey varie entre différents modèles de climats mais est relativement bien capturé. En revanche, les simulations montrant un fort effet Albretch au travers de l’ajustement du contenu en eau nuageuse (Liquid Water Path, LWP) sont en désaccord avec les observations.
L’éruption d’Holuhraun en 2014-2015 offre des conditions idéales de par la nature des émissions (on/off), mais d’autres systèmes volcaniques localisés dans des environnements isolés suggèrent aussi que l’effet Albrecht demeure faible. Nous montrerons des résultats préliminaires de l’analyse des deux volcans dégazeurs les plus actifs au monde que sont Kilauea (Hawaii) et Ambrym (Vanuatu). Les résultats indiquent, qu’en moyenne, l’effet Albrecht est proche de zéro. Cette conclusion suggère que la représentation des interactions aérosol-nuage pourrait être grandement simplifiées dans les modèles de climat et que les modèles qui simulent un fort effet Albrecht devrait être révisés. Néanmoins, il reste possible que pour des systèmes nuageux pris individuellement, l’impact des aérosols sur les propriétés micro/macro-physiques et/ou les précipitations existe, indiquant que plus de travaux sur ces questions restent nécessaires, au travers notamment de simulations à haute-résolution et de l’analyse des observations in-situ et télémétriques disponibles à la communauté des modélisateurs des aérosols et du climat.
1 Gettelman, A. et al., Nat. Geosci. 8, 243, doi:10.1038/ngeo2376, 2015
2 Malavelle, F. et al., Nature, 546, 485-491, doi:10.1038/nature22974, 2017
Mercredi 5 juin à 10h en salle OSUR, Irene Reinares (LACy)
The controls on precipitation over northern Africa during a dust outbreak
Precipitation in northern Africa occurs mainly during the monsoon season. It arises from the interaction of atmospheric processes across a wide range of scales, making its prediction challenging. The control mechanisms on precipitation are examined during a well-documented case study of dust emission and transport on 9-14 June 2006. The same method for cloud detection and tracking was applied on satellite observations and several numerical simulations (with explicit or parameterized convection) to investigate the precipitating systems. Among the various types of systems identified, mesoscale convective systems (MCSs) yield most of the total precipitation, with an observed contribution of 66%. The greatest precipitation producers are the long-lived MCSs (i.e., that last more than 6 h), at the origin of 55% of precipitation. These MCSs become more organized, i.e., larger, longer-lived and faster, as they propagate westward. The convection-permitting simulations capture the rainfall partition, but do not fully reproduce the organization of the long-lived MCSs. The simulation with parameterized convection fails to correctly represent the rain partition. This shows the added-value provided by the convection-permitting simulations. The radiative effect of dust is then analyzed, by comparing two convection-permitting simulations, with and without dust-radiation interaction. The direct effects are a mid-level warming and a near-surface cooling mainly in the western parts of northern Africa, which tend to stabilize the lower atmosphere. One semi-direct effect is a decrease in precipitation. This rainfall drop is explained by a too low number of long-lived MCSs which, nevertheless, are longer-lived and more efficient in terms of precipitation production. The diminution in the number of long-lived MCSs is due to the stabilization of the atmosphere inhibiting the triggering of convection.
Avril
Jeudi 25 avril à 10h en salle OSUR, Nils P. Wedi (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
Earth System modelling at the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
The gradual progress in global numerical weather prediction includes a systematic approach to assess and quantify the associated forecast uncertainty by means of high-resolution ensembles of assimilation and forecasts. This involves simulations with billions of gridpoints, the continuous assimilation of billions of observations, rigorous verification, validation and uncertainty quantification, and it involves increasing
model complexity through completing the descriptions of the global water and carbon cycles.
The coupling of atmosphere, land-surface, ocean, sea-ice, and waves in ECMWF's Earth-system model
requires a careful consideration of the highly varying temporal and spatial scales of the individual
processes at the interfaces and their consistent initialization.
This talk will describe recent progress for improving the analyses and forecasts, with a particular
emphasis on tropical cyclone prediction and tropical dynamics. The latter is not only important for the longer term prediction of phenomena such as the MJO, but also for example to better use and constrain the assimilation of winds and temperature in the tropical stratosphere.
Agenda 2018
Décembre
Vendredi 14 décembre à 10h45 en salle OSUR, Julien Cattiaux (CNRM)
Cyclones tropicaux et changement climatique : que disent les modèles de climat ?
L'évolution des cyclones tropicaux (fréquence, intensité, trajectoire, saisonnalité, etc.) en climat plus chaud reste largement incertaine. La théorie est mal connue, les séries d'observations sont hétérogènes dans le temps et l'espace, et les modèles de climat sont jusqu'à présent trop peu résolus (>100km) pour bien représenter ces phénomènes. Deux options s'offrent néanmoins : 1. effectuer des simulations dédiées à haute résolution (<50km) et y détecter les cyclones tropicaux via des algorithmes de "tracking", ou 2. exploiter les simulations à basse résolution en cherchant des liens entre l'activité cyclonique et l'environnement de grande échelle, t.q. des indices de cyclogénèse. Je parlerai ici de ces deux pistes de recherche qui ne mènent pas toujours aux mêmes résultats. Je détaillerai comment la configuration basculée-étirée d'ARPEGE permet d'améliorer considérablement la représentation des cyclones tropicaux, présenterai quelques résultats issus des simulations réalisées pour le projet RenovRisk, et comparerai aux résultats obtenus à partir des indices de cyclogénèse, en essayant de réconcilier les deux approches.
Mardi 4 décembre à 10h45 en salle OSUR, Ryan Neely (Université de Leeds)
Novel Ways to See More: Polarised Active Remote Sensing
Polarisation is the phenomenon in which waves of electromagnetic radiation are restricted in the direction of vibration. The only reason polarisation state is worth contemplating is that two beams of radiation, otherwise identical, may interact differently with matter if their polarisation states are different. Thus, observing the polarisation of scattered light in the atmosphere provides a unique way to probe clouds, precipitation and aerosol. In this seminar, we will review polarised active remote sensing and how these techniques may be used to explore the atmosphere in novel ways. This will include the discussion of current (fuzzy logic) and innovative approaches (Iterative/recursive clustering) to hydrometeor classification algorithms which we will apply to the data coming from the radar I am deploying as part of the CONCIRTO campaign at the Maido Observatory.
Aout
Mercredi 29 aout à 14h en salle OSUR, Michael Sicard (Remote Sensing Lab, Barcelona, Spain)
Aerosol lidars and observations at the Remote Sensing Lab., Barcelona, Spain
The Remote Sensing Lab. (RSLab) at the Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, develops aerosol lidars since year 1993. It is part of EARLINET (European Aerosol Research Lidar Network) since its beginning in 2000, and also belongs to ACTRIS (Aerosol, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure). Presently the group operates 1 advanced, multi-wavelength 3beta+2alpha+2delta+1WV lidar, and a continuous 24/7 micro pulse lidar. It also runs a polarized sun/sky-photometer and shortwave and longwave radiative flux sensors.
The presentation will give a general presentation of the RSLab and its instruments, and then focus on recent studies performed by the group: 1) monitoring of long-range transport of Canadian wildfires to the Iberian Peninsula in September 2017, 2) some interesting results about shortwave/longwave radiative forcing studies of mineral dust, and 3) aerobiological particles (pollen) monitoring with lidar
Juillet
Mardi 10 juillet à 10h en salle OSUR, Aurélien Dommergue (IGE Grenoble)
Observations du mercure atmosphérique depuis l'Antarctique jusqu'aux Tropiques
Le mercure est un polluant global émis en partie par les activités humaines (orpaillage, combustion) et le volcanisme. Une fois déposé il pourra s'accumuler et se concentrer dans les chaînes alimentaires marines exposant via l'alimentation des millions de personnes à ce composé extrêmement toxique. A travers des observations atmosphériques, nous essayons de comprendre comment ce polluant voyage et comment il peut se déposer vers les surfaces environnementales. Nos mesures s’intéressent particulièrement aux régions peu documentées comme les régions antarctiques, les sites de hautes altitudes et sites tropicaux où nous suspectons une réactivité atmosphérique plus intense susceptible d'avoir des conséquences sur le cycle hémisphérique de ce contaminant.
Juin
Lundi 25 juin à 9h30 en salle OSUR, Marcelo de Paula Corrêa (Director of the Natural Resources Institute, Federal University of Itajubá, Brazil)
Soleil, pollution et santé: Résultats des études interdisciplinaires développées en Amérique du Sud et en Europe
Jeudi 7 juin à 11h en salle OSUR, Hélène Vérèmes (LACy)
Variabilité spatiale et saisonnière des nuages sur l'océan Indien à partir des produits DARDAR v2
L'objectif de cette étude est de caractériser la variabilité spatiale et saisonnière des nuages au-dessus de l'océan Indien à partir d'observations satellitaires. Les mesures CALIPSO et CLOUDSAT sont traitées en synergie pour produire les données DARDAR (raDAR/liDAR). Le produit DARDAR_MASK fournit une classification thermodynamique des nuages (glace, eau surfondue, nuage d'eau liquide, pluie froide, pluie chaude....) sur la trace du satellite. Ce séminaire présentera la méthodologie mise en place pour calculer les fréquences d'occurrence saisonnière et mensuelle des nuages dans un domaine s'étendant de 5°S et 60°S et 35°E à 95°E. Des cartes de couvert nuageux ainsi que la distribution verticale des nuages en différentes régions seront analysées sur la période 2007-2010. Une attention particulière sera portée aux régions Canal du Mozambique/Madagascar et La Réunion/Maurice qui sont marquées par une forte saisonnalité en terme de couverture nuageuse, d'occurrence des pluies et de convection.
Mai
Mercredi 16 mai à 10h en salle OSUR, Jean-Philippe Duvel (LMD)
Impact de la MJO sur l'initiation et et l'intensification des dépressions tropicales sur l'Océan Indien
Avril
Vendredi 27 avril à 10h en salle OSUR , Joel Van Baelen (LAMP)
Systèmes Précipitants: les liens entre vapeur d'eau, relief et microphysique.
En s'appuyant sur la restitution du champ de vapeur d'eau par tomographie à partir de mesures de
réseaux de stations GPS, mais aussi sur l'observation de la dynamique des systèmes précipitants à
l'aide de radars en bande C et X, et aussi sur l'étude des profils de distribution de gouttes des pluies à
l'aide de micro rain radars déployés lors des campagnes, telles que COPS et HYMEX notamment, nous
investiguerons les liens existant entre systèmes convectifs/précipitants et leur évolution avec la
dynamique de la vapeur d'eau, l'impact du relief et la caractérisation microphysique des pluies.
Ainsi, d'une part nous observerons que la vapeur d'eau modulée par son écoulement en fonction du
terrain agit comme un précurseur à l'initiation convective, tandis que d'autre part nous montrerons
que le relief est également amené à modifier l'évolution de la microphysique des pluies au cours de
leur chute.
Agenda 2017
Décembre
Mardi 6 Décembre à 11H en salle OSUR, Bernard Legras (LMD/ENS)
La mousson d'Asie est la région la plus convective pendant l'été boréal qui se situe aussi au dessus de la région la plus polluée de la planète. Le projet européen StratoClim qui a pour but d'en étudier l'impact sur la TTL et la stratosphère a réalisé pendant l'été 2017 une campagne aéroportée avec l'avion Geophysica depuis le Népal. Le séminaire présentera cette campagne et ses tous premiers résultats et discutera le transport dans la région de la mousson d'Asie où l'anticyclone d'altitude ventile les sources convectives, piège l'air pollué issu de la surface et favorise l'entrée dans la stratosphère sur son flanc est. On discutera aussi de l'ATAL, couche d'aérosol apparue vers 16 km d'altitude au coeur de l'anticyclone et de sa probable origine anthropique.
Novembre
Mardi 28 Novembre à 10H en salle OSUR, Damien Vignelles
Damien Vignelles – Post-doctorant chercheur en instrumentation CEMHTI
Caractérisation du LOAC (mini compteur de particule) dédié à la mesure de la variabilité des
aérosols stratosphériques
L’étude des aérosols stratosphériques est importante pour comprendre le bilan radiatif
terrestre ainsi que la physico-chimie de ce compartiment atmosphérique. A l’heure actuelle,
notre représentation des différents types de particules stratosphériques et leurs répartitions
spatiale et temporelle n’est pas complète.
Nous montrons que la mesure de la concentration en particules sous ballon météorologique
au moyen d’un nouveau mini compteur de particules, le LOAC, pourrait permettre de rendre
compte de la possible variabilité locale du contenu en aérosols stratosphériques dans la
gamme de taille 0,2 à 100 μm en diamètre. La première partie de ce travail consiste à
caractériser plus précisément les performances du LOAC sous ballon météorologique
appliqué à la mesure en stratosphère. La seconde partie propose une analyse comparée du
contenu en aérosols stratosphériques obtenu par LOAC, à partir de lâchers de ballons en
France régulièrement depuis 3 ans et plus ponctuellement à l’étranger dans des situations
particulières (volcan, mousson), et par d’autres types de données (Observations spatiales,
lidar sol et simulation globale). Nous montrons alors que l’instrument possède une limite de
détection rendant difficile la mesure des particules submicroniques lors de période de fond
en moyenne stratosphère pour des concentrations de l’ordre d’une particule par cm 3. Dans
sa version actuelle, le LOAC permet de documenter les panaches volcaniques en
troposphère ainsi qu’en basse stratosphère. En perspective, nous proposons des directions
pour la calibration et l’analyse des futures données d’une nouvelle génération de l’instrument
en développement.
--
Characterisation of the LOAC (miniature aerosol counter) dedicated to the measurement of
the variability of stratospheric aerosols
The study of the stratospheric aerosols is important to our understanding of the terrestrial
radiative budget and the chemical-physics of this atmospheric compartment. Our current
comprehension of the different types of stratospheric particles and their spatial and temporal
distribution is incomplete.
We are showing that measuring particle concentrations by the means of a new balloon-borne
miniature particle counter, the LOAC, may allow us to determine the local variability in
stratospheric aerosols in the size range 0.2 –100 μm in diameter. In that respect, the PhD
thesis consists of a first phase of a more accurate characterisation of the LOAC’s
performances under balloon-borne measurement. A second phase consists of comparative
analysis of stratospheric aerosol content based on a LOAC dataset obtained during a
continuous campaign of balloon launches in France, along with some occasional flights
abroad under particular circumstances (volcanic eruption, monsoon). Thus we show that the
LOAC has a detection limit that restricts the measurement of submicronic particles in
volcanic quiescent periods for concentrations lower than typically 1 particle per cm3. In its
current version, the LOAC allows us to characterise aerosols in volcanic plumes in the
troposphere and lower stratosphere. And, further, we propose directions concerning possible
calibration and analysis strategies for the future data from the next generation of the LOAC
currently in development
Vendredi 24 Novembre à 14H en salle OSUR, Alexis Mouche
Titre: Utilisation des radiomètres et radar à haute résolution embarqués
sur satellites pour l'étude des cyclones
Résumé:
Les nouvelles techniques d'observations disponibles par satellites micro-ondes ont
permis le développement de méthodes innovantes pour la mesure du vent de surface à
l'échelle globale. En particulier, de récents travaux ont montré que la dynamique du signal
mesuré et la taille des images acquises par les radiomètres en bande L et les radars à
haute résolution (SAR) en bande C peuvent compléter les observations classiquement
effectuées par les diffusiomètres.
Cette présentation s'attachera à montrer les possibilités de ces capteurs pour
l'observation des cyclones tropicaux et illustrera ce qu'il est prévu de faire pendant la
saison des cyclones dans la région sud-ouest de l'océan Indien et en particulier dans le
cadre de RenovRisk. Les spécificités de chacun de ces capteurs et les stratégies mises en
place pour le développement des méthodes de mesures de vent de surface seront
présentées. Les performances et limitations de chacun de ses instruments mais aussi la
cohérence/complémentarité des mesures de vent issues de ces deux techniques
différentes seront discutées. La capacité unique du radar à haute résolution à mesurer le
spectre 2D de houle sera également présentée. Un exemple de co-analyse de mesures de
houle avec les mesures de vent radiomètre/SAR pour décrire de manière cohérente à la
fois le champs de vent dans les cyclones et le champ de vagues générées sera montré.
Septembre
Mercredi 27 Septembre à 13H en salle OSUR, Séminaires M1 RNET
Marc Dumont (doctorant du LGSR) présentera une partie de ses travaux: « La géophysique héliportée à La Réunion: apport pour la compréhension de l’hydrogéologie ».
Jeudi 14 Septembre à 10H en salle OSUR,Olivier Delage : Analyse multi spectrale de séries temporelles.
Titre : Analyse d’un ensemble de séries temporelles (Analyse multivariée) :
Application à l’analyse de la variabilité de la composition de l’atmosphère.
Résumé : L’analyse de la composition de l’atmosphère et son suivi dans le temps joueun rôle important dans l’étude du changement climatique. Cette présentation, dédiée à la caractérisation de la variabilité de la composition de l’atmosphère, s’appuie sur le couplage de deux types de techniques numériques relativement récentes et potentiellement prometteuses.
Le premier type de technique, connue sous le nom de « séparation aveugle de sources » consiste à estimer un ensemble de sources inconnues à partir d’un jeu d’observations. Ces observations résultent du mélange de ces sources et proviennent des capteurs. Ce type de technique peut s’appliquer à l’identification et au calcul des proportions des différents composants d’un mélange gazeux tel que l’atmosphère.
Le deuxième type de technique s’appuie sur l’analyse de séries temporelles non linéaires de mesures avec pour objectif de caractériser et de prédire la dynamique observée.
L’atmosphère peut être considérée comme un système complexe et la variabilité de sa composition est le résultat d’un ensemble de processus physique ayant des échelles de temps et d’espace différents faisant intervenir un grand nombre de composants.
Le couplage de ces deux techniques pourrait permettre de caractériser la variabilité de la composition de l’atmosphère : le premier type de technique permet de quantifier certains composants de l’atmosphère (CO, CO2, vapeur d’eau, ozone, ...) tandis que le deuxième type de techniques permet de suivre et de caractériser l’évolution de la concentration de ces composants. Un tel couplage peut aussi servir de base pour étudier les facteurs liés au changement climatiques comme l’effet de serre ou la teneur en vapeur d’eau pour l’élaboration d’un modèle climatique local. Il peut aussi permettre d’étudier l’évolution des propriétés optiques de l’atmosphère (coefficient
d’absorption, coefficient de diffusion) pour caractériser la propagation d’un rayonnement dans l’atmosphère.
Juin
Vendredi 16 Juin à 10H Rui Fernandes "GNSS for geosciences : from second to secular" en salle OSUR.
Seminar on Friday 16th of June 2017, 10H, Salle OSU-R
Pr. Rui Fernandes
SEGAL / UBI
Space and Earth Geodetic Analysis Laboratory / University of Beira Interior
Covilhã, Portugal
Title : "GNSS for Geosciences: from second to secular"
Abstract : The advent of GNSS systems created a multitude of new technical and scientific applications that are nowadays dependent of this space-based system requiring accuracies from meters (e.g., navigation) to millimeters (e.g., deformation monitoring) level. The focus of this talk is to present some geodetic research activities and practical projects that have been carried by SEGAL (UBI/IDL) and that are serving the scientific community.
We start by discussing the accurate estimation and interpretation of secular motions due to tectonic and subsidence/uplift processes. A major issue is to separate on the estimated time-series the secular motions due to plate tectonics from other signals. Various other phenomena, such as loading effects, local crustal movements, postglacial rebounds etc., additionally affect the time-series of a ground monument position and should be taken into account.
We will also focus on issues related with the application of GNSS to evaluate sudden displacements (second level) due to seismic events. In this respect, geodetic observations can play a crucial role in Early Warning Systems and GNSS-Seismology.
Additionally, we will discuss other scientific applications, in particular the use of GNSS as an atmospheric sensor. GNSS is nowadays being currently used as a common tool for atmospheric precipitable water content (PWV) and ionospheric total electron content (TEC) monitoring.
Jeudi 15 Juin à 10h en salle de l'OSU-R : William Bruch
Titre: Etude numérique de l'impact des vagues (gravitaires et infragravitaires) sur l'hydrodynamique d'un récif frangeant (La Saline, La Réunion)
Résumé: Parmi la diversité de récifs coralliens présents dans les zones tropicales, les récifs de type frangeant (comme celui de La Réunion) sont les plus courants. Avec un comportement semblable à un filtre passe-bas, une structure récifale frangeante constitue une défense côtière importante et efficace contre l'action des ondes gravitaires de fréquence haute (soit des périodes courtes comprises entre 4s et 18s en général). En revanche, l'efficacité de ce filtre dépend des états de mer (énergie spectrale et niveau d’eau), et les ondes infragravitaires caractérisées par leur fréquence basse (soit des périodes longues de l'ordre de 30s à 3min environ) peuvent passer le récif et constituent ainsi le transfert d’énergie dominant au-dessus du platier récifal.
Ce stage constitue une première approche de modélisation numérique de ces phénomènes, pendant un évènement de houle australe en Juin 2014.
Avril
Jeudi 6 Avril à 10h en salle de l'OSU-R : Gilles Molinié du LTHE
Single Camera Disdrometer: taille, vitesse et forme des gouttes de pluie
Gilles Molinié, IGE-UGA, Grenoble
Ce séminaire présente le fonctionnement et les performances d’un capteur de la taille, de la forme et de la vitesse des gouttes de pluie que nous concevons au LTHE (IGE-Grenoble) depuis 2009.
Connaı̂tre la distribution de la taille des gouttes de pluie est indispensable pour calculer des paramètres intégrés tels que la quantité de pluie tombée, l’intensité de la pluie, son énergie cinétique ou encore la réflectivité radar et ainsi comparer des mesures radar à celles de pluviomètres, disdromètres ou à des sorties de modèles par exemple.
Ces calculs de paramètres intégrés sont sensibles à la forme des gouttes, souvent l’hypothèse de sphéricité est faite. Or les mesures par caméras rapides en soufflerie ou de gouttes lachées depuis plusieurs dizaines de mètres de hauteur, montrent que plus les gouttes sont grosses plus leur forme varie au cours de leur chute.
Les disdromètres classiques du commerce à une dimension ne peuvent pas mesurer cette évolution de la forme. Elle est donc déduite de la relation entre vitesse et taille apparente des gouttes.
Un autre challenge important de la mesure de la taille des gouttes de pluie est la résolution temporelle
qui induit la résolution spatiale. Une haute résolution temporelle est nécessaire pour identifier les processus microphysiques, mais elle contraint un grand volume d ́échantillonnage pour la robustesse des mesures. Pour la plupart des capteurs du commerce, la résolution est limitée par la densité des gouttes de pluie.
Pour palier aux différentes limitations indiquées ci-dessus, le SCD utilise une technologie originale basée
sur la stéréo-ombroscopie des gouttes de pluie.
Mars
Jeudi 30 Mars à 10H en salle OSU-R : Joris PIANEZZE
Titre :
Interactions océan-vagues-atmosphère dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien : étude du cyclone tropical Bejisa (La Réunion, 2014)
Résumé :
Les cyclones tropicaux sont le siège de nombreuses interactions océan-vagues-atmosphère (OVA) à des échelles spatiales et temporelles multiples. Afin de quantifier au mieux les mécanismes en jeu dans ces interactions, des modèles de circulation hydrodynamique (CROCO), atmosphérique (Meso-NH / SurfEx) et d'états de mer (WW3) ont été couplés à l’aide du coupleur OASIS3-MCT (travail basé sur les travaux présentés dans Voldoire et al. (2017, en préparation)). Une configuration de ce système a été mise en place dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien autour de Bejisa, un cyclone tropical ayant frôlé les côtes réunionnaises en janvier 2014. Après une description des interactions OVA en surface, l’influence du couplage sur la structure thermodynamique du cyclone, la couche limite océanique ainsi que sur l’état de la mer sera présentée.
Fevrier
Vendredi 24 Février de 10H à 12H en salle OSU-R : Guillaumme Guimbretiere du CEMHTI d'Orléans
Impact environnemental d'un phénomène éruptif : apports de la spectroscopie et de l'imagerie
Combinées, spectroscopies et imageries permettent des analyses physico-chimiques locales fines situées dans un contexte global.
Nous aborderons, à travers des exemples, l'apport de ces outils dans des problématiques liées à l'environnement volcanique actif:
Premièrement, l'étude de l'évolution de la minéralogie secondaire dans un tunnel de lave de l'éruption de 2007.
Enfin, des travaux à venir sur la caractérisation des émissions proches de l'évent et de leurs processus de transport dans l'environnement.